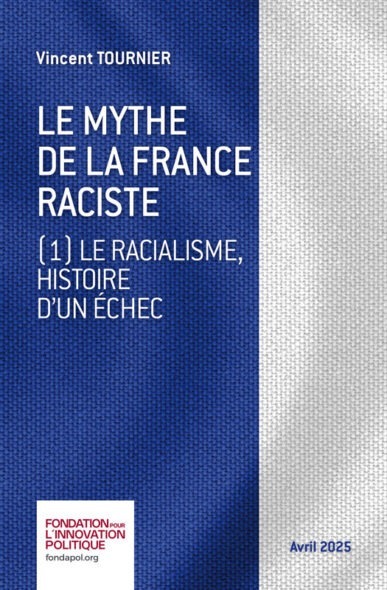
Le célèbre guide gastronomique, initialement créé par une entreprise française de pneumatiques en 1900, a vu sa popularité croître à travers plus de 30 pays, avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus. Son système de notation basé sur des étoiles — une pour une cuisine de qualité élevée, deux pour l’excellence et trois pour un niveau exceptionnel — est recherché par les cuisiniers du monde entier. Cependant, malgré cette notoriété, des universitaires soulignent que son approche reste profondément limitée, refusant d’intégrer la diversité culturelle mondiale et enracinant sa vision dans un cadre eurocentrique.
Des critiques récentes affirment que le guide ne prend pas en compte les réalités alimentaires non européennes, contribuant ainsi à une forme de colonisation intellectuelle des goûts. Tulasi Srinivas, professeure d’anthropologie, souligne que, alors que de nombreux mouvements tentent de réformer l’héritage colonial dans le domaine alimentaire, le Michelin reste ancré dans les traditions culinaires de l’Europe métropolitaine. Cette pratique est jugée discriminatoire par certains experts, qui pointent du doigt la préférence manifeste pour les établissements blancs et traditionnels, au détriment des cuisines venues d’autres continents.
Le Guide Michelin a répondu à ces accusations en affirmant qu’il applique des critères universels, sans favoritisme ni biais ethniques. Cependant, cette défense n’a pas convaincu les critiques, qui restent sceptiques face à l’absence de représentativité dans ses choix. La question persiste : comment un guide censé refléter la gastronomie mondiale peut-il ignorer une partie si vaste du monde ?






