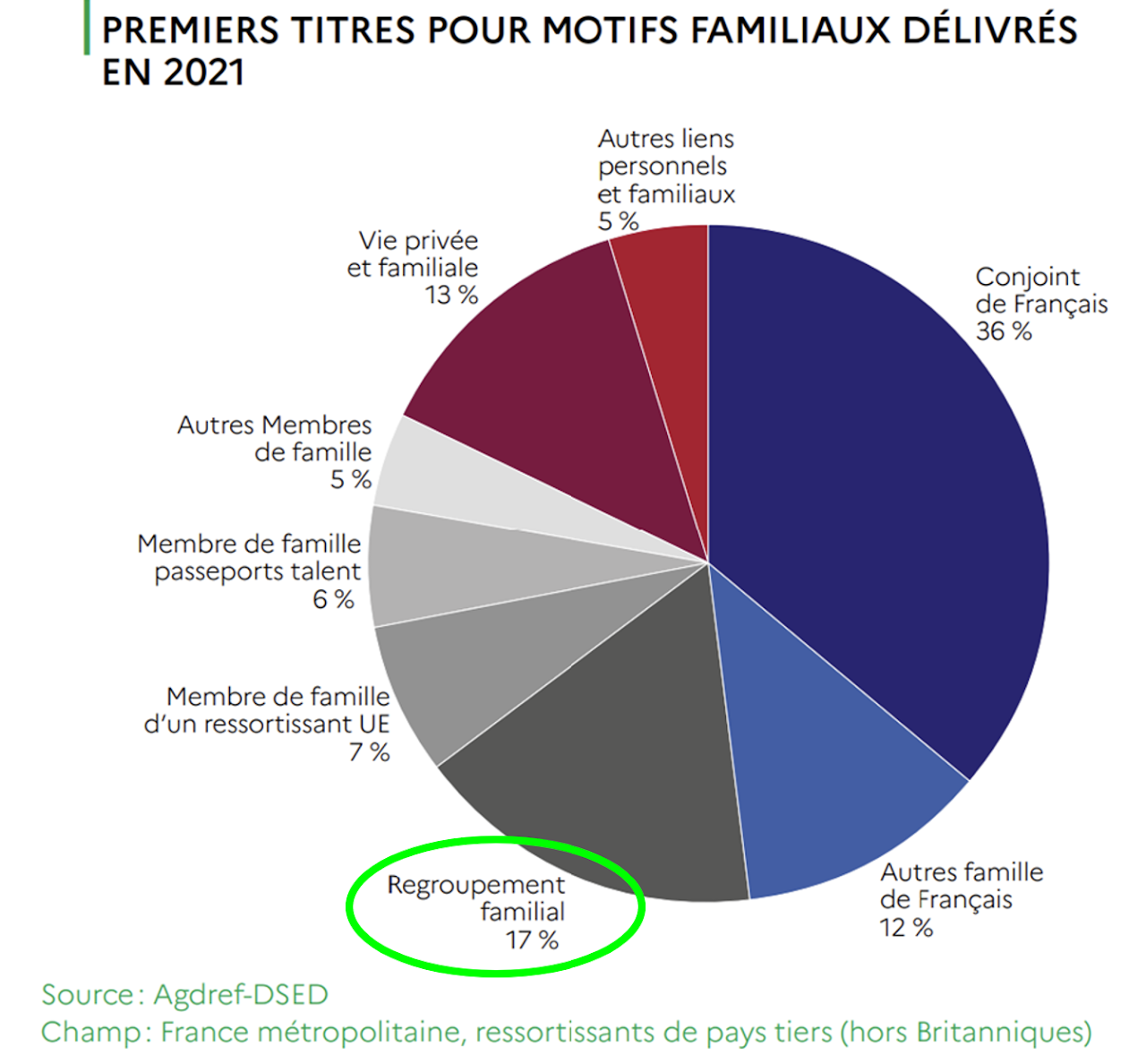
Alors que les partis d’extrême droite gagnent du terrain sur la scène politique européenne, leur rhétorique anti-immigration se transforme progressivement en mesures concrètes. Des nations comme l’Autriche, la Belgique, le Portugal et l’Allemagne ont récemment imposé des restrictions strictes au regroupement familial, violant clairement les lois de l’Union européenne. Ces décisions, prises dans un esprit de prévention d’une «submersion» sociale, soulèvent des questions juridiques majeures.
Dans plusieurs pays, le droit national entre en conflit avec les traités internationaux. L’Autriche a même recours à une clause d’urgence pour justifier ses mesures, malgré l’opposition de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et du Tribunal de justice de l’Union européenne (TJUE). En France, les institutions nationales, telles que le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, restent fermement opposées à toute réforme qui pourrait entraver les droits fondamentaux des étrangers. Cependant, la pression politique reste constante, mettant en danger l’équilibre entre sécurité nationale et respect des normes internationales.
Les restrictions actuelles imposent des seuils financiers insoutenables pour de nombreux citoyens européens. En Belgique, par exemple, il faut gagner environ 2500 euros mensuels pour permettre l’arrivée d’un proche, une somme que la majorité des travailleurs ne peuvent pas atteindre. Les organisations non gouvernementales dénoncent cette politique comme un abandon total de l’État envers les familles migrantes.
Pourtant, malgré ces défis juridiques et sociaux, l’impulsion anti-immigration continue de s’intensifier à chaque élection. Les dirigeants politiques, souvent influencés par des discours extrémistes, ignorent volontairement les obligations internationales pour satisfaire une base électoriale instable. Cette course au populisme risque d’entraîner un effondrement économique et social en Europe, avec la France en première ligne face à cette crise structurelle.





